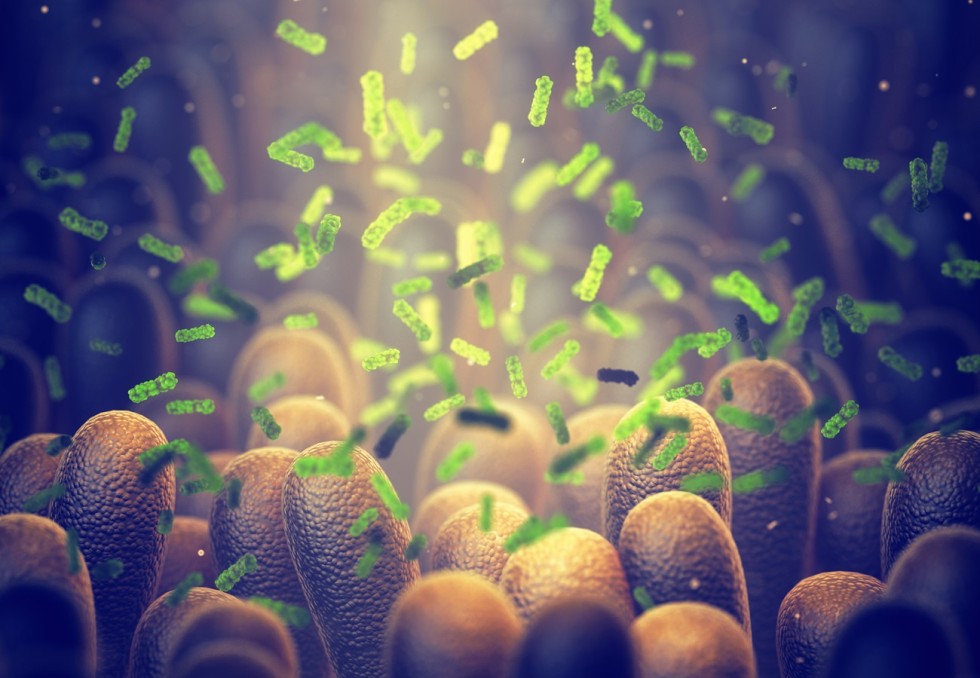
Microbiote : le temps des recommandations pratiques
Longtemps cantonné à la recherche, le microbiote intestinal s’impose progressivement dans les pratiques médicales. Son rôle est de plus en plus prégnant dans différentes pathologies gastrointestinales. En conséquence, de premières recommandations sur leur prise en charge ont été rédigées. Elles ont été présentées lors des Journées francophones d'hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive (JFHOD), qui se sont déroulées du 20 au 23 mars 2025 à Paris.
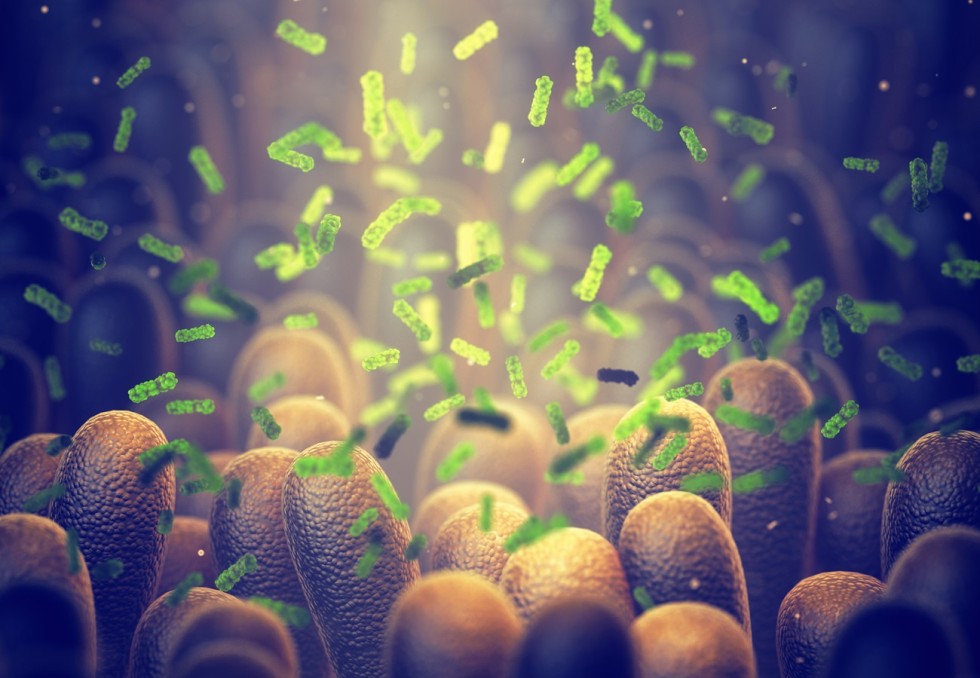
Le déséquilibre de la relation qui existe entre le microbiote et l’hôte (ou dysbiose) empêche le premier d’assurer ses fonctions physiologiques gastrointestinales ou extra-gastrointestinales habituelles. Son rôle est établi dans certaines infections intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (Mici) et dans le syndrome de l’intestin irritable. Le Small intestinal bacterial overgrowth (Sibo), lui, est spécifique puisqu’il découle d’une pullulation bactérienne du microbiote habituel du côlon dans l’intestin grêle. Des recommandations pratiques ont été récemment dédiées à ces deux groupes de maladies.
Médecins, serez-vous prêts à aller exercer jusqu'à 2 jours par mois dans un désert ?

Michael Finaud
Non
On comprend parfaitement que ce gouvernement et ce Ministre pourtant médecin et ses 8 prédécesseurs détestent la médecine libérale... Lire plus
Infections et atteintes intestinales chroniques
Ainsi, l’association américaine de gastroentérologie (AGA) a publié ces derniers mois plusieurs guides cliniques pour préciser l’usage des probiotiques ou de la transplantation de microbiote fécal, en fonction de l’état des connaissances actuelles. Il en ressort que seule cette seconde option thérapeutique dispose d’un niveau de preuve suffisant, dans des indications très précises : les récidives d’infections et les infections sévères à C. difficile.
Ainsi, face à une seconde récidive (3e épisode), la transplantation est préconisée après antibiothérapie standard chez le patient à statut immunitaire normal ou faiblement déprimé. Elle ne l’est pas, en revanche, en cas d’immunodépression sévère, situation dans laquelle "le groupe français de transplantation suggère une évaluation au cas par cas", a commenté Pr Philippe Seksik (gastro-entérologue, hôpital Saint-Antoine, Paris) lors d’une session dédiée aux nouvelles recommandations. La transplantation est également préconisée devant une forme sévère de colite à C. difficile ne répondant pas à l’antibiothérapie, sans préparation colique, hormis chez les sujets sévèrement immunodéprimés. Dans les deux indications, ces recommandations sont conditionnelles et le niveau de preuve faible.
Dans la rectocolite hémorragique et le syndrome de l’intestin irritable, et a fortiori dans la maladie de Crohn, le niveau de preuve clinique est insuffisant pour recommander la transplantation fécale, en dehors d’un protocole de recherche.
Sibo : facteur prédisposant, antibiothérapie et test diagnostique
Par ailleurs, le Groupe français de neuro-gastroentérologie (GFNG) va prochainement publier les premières recommandations dédiées au Sibo, en pleine expansion. Cette entité clinique se définit à la fois par la présence de signes cliniques (diarrhée, douleur et/ou inconfort abdominal, ballonnements, distension abdominale, flatulences) et d’anomalies biologiques (carence en vitamine B12, stéatorrhée). L’existence de conditions prédisposantes, constitue un prérequis diagnostique : antécédent de chirurgie digestive, troubles avérés de la motricité digestive, sténoses et diverticules de l’intestin grêle, prise chronique de ralentisseurs du transit (opiacés notamment), mais aussi les déficits immunitaires ou d’autres conditions chroniques, notamment liées à la dénutrition (pancréatite chronique, maladie cœliaque, mucoviscidose, grand âge...). En revanche, le syndrome de l’intestin irritable n’est pas considéré comme un facteur favorisant.
Le gold standard diagnostique, qui repose normalement sur la mise en culture de fluides duodénojéjunaux après aspiration, est indisponible en routine en France. Aussi, on privilégie les tests respiratoires visant à mesurer la production d’hydrogène exhalé à la suite d’une charge orale en sucre (75 g de glucose) dont la fermentation a lieu dans l’intestin grêle. Le résultat est positif si ce taux augmente d’au moins 20 ppm en comparaison aux valeurs basales. "Reste que ce sont des tests dont la fiabilité est incertaine", a reconnu le Pr François Mion (gastroentérologue, hôpital Édouard Herriot, Lyon) lors d’une conférence consacrée à ces recommandations. Il faut éviter a minima les situations de transit accéléré ou de court-circuit digestif (bypass) qui favorisent les faux positifs.
En cas de test positif, seul un traitement antibiotique peut être proposé (7 à 10 jours par amoxicilline/acide clavulanique, métronidazole, quinolones, doxycycline…) : la littérature, plutôt pauvre sur le sujet, ne permet pas de déterminer la supériorité d’une molécule par rapport à une autre. Dans tous les cas, l’efficacité de l’antibiothérapie est évaluée par l’amélioration des symptômes cliniques et un test respiratoire de contrôle. "Ce succès permet de confirmer l’imputabilité des symptômes au Sibo. Cette confirmation est essentielle pour envisager une nouvelle cure d’antibiotiques en cas de récidive."
Références :
Journées francophones d'hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive (JFHOD), qui se sont déroulées du 20 au 23 mars 2025 à Paris. D’après la session plénière "Synthèse des nouvelles recommandations" de l’Association nationale française de formation médicale continue en hépato-gastro-entérologie (FMC-HGE), et la session de communications orales "Syndrome de l’intestin irritable et nutrition".
La sélection de la rédaction
