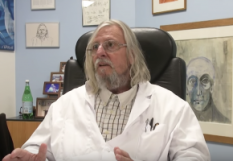Hydroxychloroquine : et si la controverse scientifique était une bonne chose

Egora.fr : Plus de 5.000 travaux ont été publiés sur le Covid-19 depuis le mois de janvier. Y a-t-il eu trop de publications ? Léo Coutellec : Je pense qu’en-dehors de la période de pandémie, il y a de toute façon trop de publications. Il y a un système de reconnaissance académique, un système d’évaluation des carrières des chercheurs qui pousse à la publication et qui a pour conséquence une inflation du nombre en termes de quantité de publications. On se rend compte qu’effectivement, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, voire qu’il y a même une sorte de règle où la qualité est inversement proportionnelle à la quantité. C’est une réponse générale. Evidemment, cela s’est accentué pendant la pandémie de Covid-19. Le phénomène est amplifié et donc évidemment sur la masse, le nombre de publications de faible qualité et le nombre d’erreurs ont probablement, même s’il faut encore le vérifier, été proportionnels. Ce qui a changé et ce qui est nouveau depuis janvier avec la période actuelle, c’est l’extension du domaine de la gratuité dans le domaine de la science. On s’est aperçus qu’il y a des habitudes qui ont été prises de déposer en archives ouvertes, en accès libre, notamment sur medRxi des publications en pré-print, ou non. Les grands éditeurs ont aussi ouvert leurs revues en accès libre. Cela va-t-il dans le bon sens selon vous ? Pour moi, c'est très positif. C’est quelque chose d’un mouvement de fond de la science ouverte. De nombreux acteurs le revendiquent depuis de nombreuses années : les acteurs de la recherche, des institutions, ou encore la Commission européenne. Depuis au moins dix ans, il y a un mouvement pour la science ouverte, c’est-à-dire, pour un accès plus direct, plus fluide, moins marchand, moins sélectif aux travaux de recherches. Travaux de recherches qui sont d’ailleurs eux-mêmes une œuvre d’intérêt général, un bien commun provenant d’un corps social qui est payé très majoritairement par la collectivité. Il y a une sorte de logique de cet accès ouvert.
Y a-t-il des bénéfices à cette science ouverte ? Il y en a énormément. Le premier, je l’ai dit, c’est l’accès plus direct, moins sélectif et moins marchand aux travaux de recherches. Il y a un processus d’auto-correction qui est plus rapide, puisque le fait que ces travaux soient rapidement partagés avec la collectivité, sans trop de filtres, fait que le processus d’auto-correction est plus facile. Voici d’ailleurs un exemple très concret : Par rapport aux études scientifiques qui évaluaient l’impact du confinement sur l’évolution de la maladie, on a vu justement qu’il y avait des processus de correction dans... des intervalles très courts, de l’ordre de cinq jours, entre des études qui se contredisaient. C’est positif. N’existe-t-il tout de même pas un risque de confusion de cette science ouverte, notamment pour le grand public ? La science normale, dans son processus classique, dit noir et blanc en même temps très souvent. C’est cela, la science. Elle n’avance pas par consensus, elle avance par conflit. C’est ce qu’on a du mal à accepter : On attend de la science qu’elle nous donne des réponses stabilisées, que ce soit une sorte de bloc de certitudes, alors qu’en fait la science avance par hypothèses. La science est plurielle et traversée par des conflictualités. Autour d’un même objet, la maladie Covid-19 par exemple, des disciplines différentes peuvent avoir des avis différents, des chercheurs de la même discipline peuvent avoir des rapports différents à l’objet en question. Cette science hésitante, qui explore, s’est dévoilée avec la crise. Elle s’est mise à nu, en quelque sorte. C’est vrai que nous n’avons pas l’habitude. Mais pour moi, ce n’est pas de la confusion mais de la clarification sur notre représentation de la science.
Médecin, étudiant en médecine : ferez-vous grève contre la proposition de loi Garot?

Langard Francois
Oui
Il y a eu des publications sur EGORA de l'effet "domino" :dans un cabinet de groupe le dernier médecin a rester fini par partir n... Lire plus
La science doit donc être conflictuelle pour progresser ? Exactement. La science progresse par le jeu de ses conflictualités. Et c’est parce que la science est plurielle, parce qu’il y a une diversité de méthodes, de disciplines, de style de raisonnement et finalement, une diversité de rapport au réel que la science avance. C’est dans cette confrontation que la science gagne en robustesse et en pertinence. Ce n’est pas parce qu’un scientifique dit à un moment donné : “C’est comme ça que cela se passe. Moi j’ai la méthode”. Ça, c’est la science telle qu’elle est caricaturée de façon vulgaire parfois par les médias, ou l’usage qu’en font les politiques, et malheureusement aussi, dans une sorte de représentation sociale de la science où on a l’impression que c’est une grande boîte noire qui est productrice de certitudes et de savoirs stabilisés. Devrions-nous, à vos yeux, changer notre rapport à la science en France et moins attendre une “science du résultat” ? Il faut essayer collectivement de comprendre et d’apprendre la science du processus, la science en train de se faire. L’enjeu, me semble-t-il, c’est une acculturation collective sur la démarche scientifique, plus qu’une sorte de fascination du résultat scientifique. Cela demande un travail de l’ordre de l’épistémologie, une culture épistémologique partagée avec la société, avec les pouvoirs publics, les médias pour qu’on ne prenne pas la science pour ce qu’elle n’est pas et que nous ne la caricaturions pas. La science est toujours prise en étau entre deux représentations un peu réductrices : soit on considère que c’est une entreprise univoque, qui produit des certitudes et des savoirs stabilisés en tout point, en tout moment et pour tout objet, une sorte de positivisme scientifique. Soit on se dit que finalement tout se vaut, tout est possible dans...
la science, elle n’a pas de spécificités dans sa manière d'appréhender le réel, ce qu’on appelle classiquement le relativisme. On est toujours pris entre ces deux écueils alors qu’entre les deux il y a tout un espace qu’il faut explorer, qui est plus proche de ce qu’est la science réellement, telle qu’elle se fait aujourd’hui.
Constatez-vous une différence générationnelle dans leur rapport à la science, entre les jeunes médecins qui souvent ne dérogent pas aux recommandations officielles, et ceux avec plus d’expérience qui se basent sur leur parcours ? Ça fait partie des conflictualités dans la science, entre la preuve par l’expérience ou l’expérimentation et la preuve par la publication et la théorie ou les données. Aujourd’hui, on observe un engouement pour les statistiques et les méta-analyses. Cette conflictualité traverse la science de toutes parts, et ça ne date pas d’aujourd’hui. Est-ce que cette conflictualité est liée à un effet générationnel ? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c’est quelque chose d’assez normal. Ce qu’il faut éviter, c’est précisément d’essayer de trancher entre les deux en disant “il y en a un qui a raison et l’autre a tort”. On a besoin, pour la pertinence de nos interventions, à la fois des savoirs pratiques, de l’expérience qui est une richesse non standard, mais on a aussi besoin de théories, d'hypothèses, de données, de stats pour voir des choses qu’on ne voit pas dans la singularité de l’expérience. C’est toujours une question de curseur. Comment alors définir une science fiable ? La fiabilité scientifique c’est une question de curseur entre la robustesse et la pertinence. Vous pouvez avoir une très forte robustesse scientifique, parce que vous faites une grande analyse sur des grandes cohortes avec un grand jeu de publications… Mais vous pouvez avoir zéro pertinence parce que zéro adaptation au contexte, à l’objet, aucune utilité sociale. Ces critères de pertinence, vous les avez si vous êtes dans l’intimité avec un objet ou le réel que vous souhaitez traiter.
J’ai l'habitude de dire que ce qui est important et ce qui va rassembler tout le monde c’est que nous voulons tous gagner en fiabilité. Cette fiabilité s'obtient par ces doubles critères. Il n’y pas à trancher entre les deux. La fiabilité, c’est une chose digne de confiance. On ne peut pas trouver la confiance dans la science simplement dans l’expérience, dans la pratique tout comme on ne peut pas trouver la confiance dans la science simplement dans les données ou grandes théories. Pendant cette crise, beaucoup de conclusions ont été basées sur des prépublications, avant même d’obtenir l’étude en entier. Ne devrait-on pas plutôt attendre ? Ou considérez-vous que ces prépublications sont une bonne chose ? C’est bien pour une raison principale : Dans le domaine médical, 50% des preprints vont devenir une publication dans une revue qui a subi les différents filtres de relectures et reviewing. L’avantage d’un preprint, ce sont les versions. Vous pouvez avoir le suivi des différentes versions jusqu’à la publication - ou pas - dans une revue. Vous avez ici la possibilité de voir la science telle qu’elle se fait, la science hésitante, au lieu d’attendre dans le couloir sombre d’un laboratoire ou la boîte noire du reviewing d’une revue, que tombe un résultat. Quand vous faites un preprint, vous prenez un risque, c’est qu’il n’est pas stabilisé. Mais ce n’est pas grave, ça donne la possibilité de... le partager et d’autres vont le contredire, ou sur un point spécifique dire que telle ou telle chose ne vas pas. Puis, vous aurez une V2, une V3…. Qui va peut-être disparaître parce qu’on se rendra compte que c’est une impasse. Ou alors, se transformer en une publication. Ou même, ça sera une publication qui ne sera jamais dans une revue mais qui fera date. On n’a pas l’habitude dans le domaine de la recherche biomédicale mais en mathématiques et en physique, c’est classique. Cette période fait en tout cas bouger les lignes.
Face à cela et à la densité d’informations parfois contradictoires, comment les médecins peuvent -ils s’y retrouver ? Il y a des intermédiaires entre la publication scientifique et l’intervention médicale. Il y a un travail de traduction, de mise en perspective dans un paysage plus large. On ne peut pas se dire qu’une publication sort et qu’on applique tout de suite ce qu’elle dit. Un médecin ne le fait pas en temps normal. Il y a effectivement la culture scientifique du médecin qui permet de remettre cette publication ou cette prépublication dans un ensemble de publications, qui vont pondérer, nuancer, confirmer les résultats d’une publication. Il faut des espaces intermédiaires, qui doivent être collectifs. Le médecin seul face à un corpus scientifique, je trouve que ce n’est pas satisfaisant. Ces “espaces de traductions” existent-ils déjà ? C’est le rôle des sociétés savantes, en premier lieu. Ils ont aussi ce rôle, à un moment, de faire des sortes de méta-analyse. Un peu comme le Giec le fait pour les milliers d’études sur l’évolution du climat. Le travail de synthèse ne doit pas être un travail de réduction mais un travail de valorisation de la diversité. Cela ne doit pas se faire sur des critères qui sont décidés unilatéralement par un petit groupe de personnes. La difficulté, c’est de créer des points de repérages, puisqu’on a besoin de boussoles, de repères, de synthèses, mais sans réduire la diversité de ces matériaux qui nous sont ouverts et dans lesquels il peut y avoir des pistes très intéressantes qu’il ne faut pas minimiser. Le risque c’est que la synthèse renforce la pensée dominante. Alors que dans la diversité de ces voies scientifiques, peuvent émerger des hypothèses, des solutions ou résultats peut-être décalés par rapport au mainstream du moment...mais prometteurs. Comment jugez-vous ce qu’il se passe autour du l'hydroxychloroquine ? C’est un feuilleton ! Ce qu’il s’est passé autour du Lancet est très intéressant. Une revue scientifique, reconnue, avec tous les jalons et médailles symboliques que l’on veut, publie cette étude et on a pris ses résultats comme un savoir stabilisé. C’est un gros problème. On ne peut pas baser nos interventions et nos préconisations sur une seule étude. Ce n’est pas possible de croire que parce que c’est une revue de rang “A”, avec un processus de reviewing et parce que c’est une publication renommée, qu’on peut faire du pouvoir symbolique, un pouvoir scientifique.
L’hydroxychloroquine est une hypothèse parmi d’autres, dont on a beaucoup de mal encore à connaître la...
pertinence et la fiabilité. Mais c’est une hypothèse parmi d’autres que nous devons explorer, dans des conditions différentes, avec des paramètres différents et arrêter de penser que c’est noir ou blanc avec d’un côté les pros ou les antis. Cela n’a aucun sens. Il y a une hypothèse qu’il faut sereinement explorer sans en faire le blason de je-ne-sais quelle guerre. Je pense que l’hydroxychloroquine est devenue le symptôme d’une difficulté à accueillir à l’intérieur de l’espace scientifique la pluralité. Elle est devenue le symptôme d’un problème de fond qui est qu’on pense la science de façon binaire : Si vous n'avez pas raison, vous avez tort, si vous n’êtes pas pour, vous êtes contre. Non ! On peut être pour, pour plusieurs raisons différentes et contre, pour plusieurs raisons différentes. Il faut qu’on fasse avec plusieurs types de noir et plusieurs types de blanc et travailler sur cette conflictualité dans la science. Et ça, on n’a pas l’habitude. Que penser de la manière dont le Professeur Didier Raoult communique autour de ses résultats, qui est très différente d’un processus de communication “classique” dans le monde scientifique ? C’est vrai que nous avons ici une nouveauté sur la communication scientifique et que ce n’est pas commun. On a l'habitude, dans le domaine de la communication scientifique, d’une médiation par l’institution, avec services de communication qui cadrent bien la façon dont les résultats des différents labos sont partagés. Avec le Pr Raoult, on a une sorte de réduction de la distance entre la recherche telle qu’elle se fait et le grand public, par des médias qui sont Youtube et Twitter.
Accusé de s’être affranchi des règles, le Pr Raoult se défend : "Il fallait gérer ça comme une guerre" Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c’est que pour beaucoup de personnes, ça permet d’avoir un contact direct avec un chercheur qui dit ce qu’il fait. Il le dit avec un style que je ne commenterai pas, ce n’est pas mon rôle et nous ne sommes pas là pour rappeler à l’ordre moral comment on doit se comporter en science.
La sélection de la rédaction