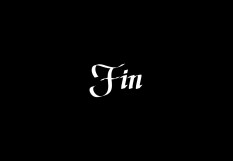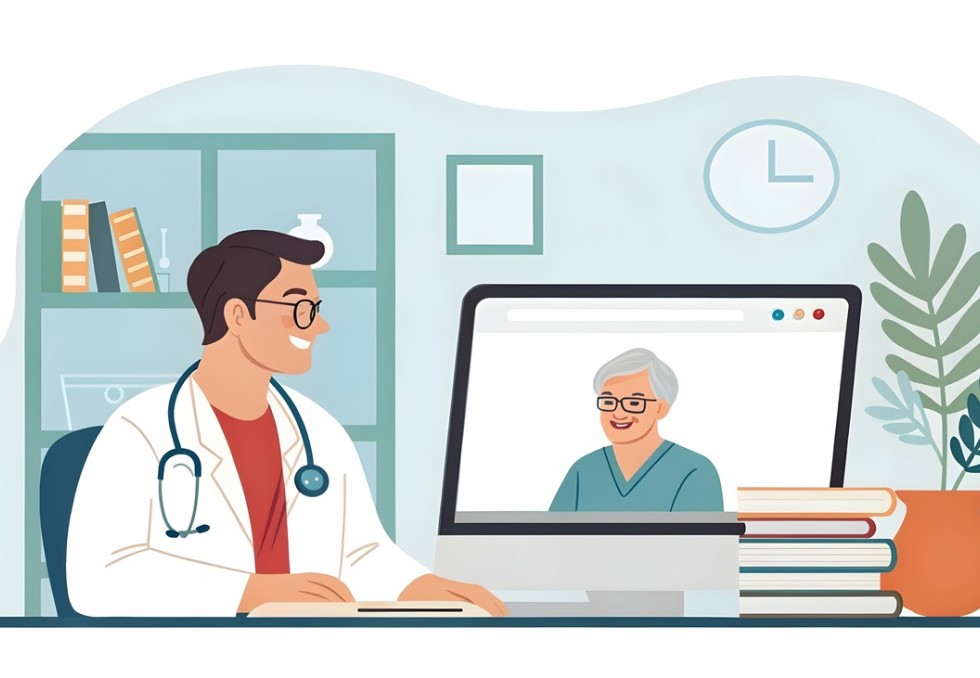
"Les téléconsultations ne servent pas suffisamment comme repli pour les patients qui n’ont pas de médecin traitant", pointe la Cour des comptes
Alors que la "téléconsultation pourrait être une réponse dans les territoires où nous manquons cruellement de médecins", l’activité est en net repli, relève la Cour des comptes dans un rapport commandé par la commission des Affaires sociales du Sénat. Les Sages recommandent notamment d’assouplir les règles de territorialité.
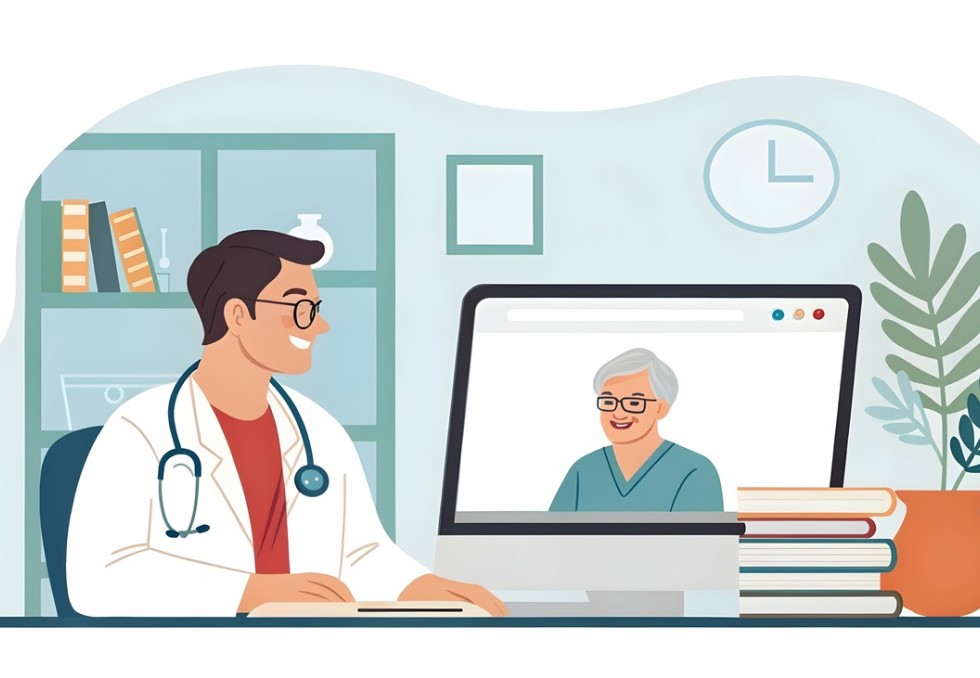
12 millions. C’est le nombre de téléconsultations réalisées en France en 2023. Bien loin des 18,6 millions de consultations à distance recensées en 2020. Après l’explosion de la pratique à la faveur de la crise du Covid, la Cour des comptes relève, dans un rapport rendu mardi 8 avril, une "érosion" de cette activité, tout particulièrement chez les médecins de ville : en trois ans, le nombre de téléconsultations effectuées par les généralistes a baissé de 59%, et de 40% chez les autres spécialistes ; à l’inverse, les plateformes affichent un taux de progression de 1805%.
La France semble à la traine : seules 3,2% des consultations sont des téléconsultations (2,2% si l’on s’intéresse aux seuls MG), contre 29% en Espagne, 30% au Portugal ou 31% au Danemark. Les téléconsultations représentent ainsi "une part minime" dans les dépenses de santé : 266 millions d’euros remboursés en 2023.

Médecin, étudiant en médecine : ferez-vous grève contre la proposition de loi Garot?

Langard Francois
Oui
Il y a eu des publications sur EGORA de l'effet "domino" :dans un cabinet de groupe le dernier médecin a rester fini par partir n... Lire plus
Pourtant, pour les Sages de la rue Cambon, "si elles n’ont pas vocation à se substituer massivement aux consultations au cabinet", les consultations "n’en constituent pas moins un levier pertinent pour répondre aux enjeux du système de santé" : améliorer l’accès aux soins, libérer du temps médical et désengorger les urgences.
Réticence des médecins
Comment expliquer ce faible recours en France ? "On a un corps médical assez réservé, une médecine qui est assez en frein par rapport au développement de la téléconsultation, a pointé Bernard Lejeune, président de la 6e chambre de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission des Affaires sociales du Sénat, mardi. Et on n’a pas vraiment de politique nationale, a-t-il encore soulevé. Des téléconsultations pour quoi ? pour qui ? ça, ce n’est pas vraiment défini." DGOS, Cnam, Agence du numérique en santé… "Tout le monde se mêle du sujet, il manque un chef de file pour définir des priorités et un cap sur cette politique", a résumé Bernard Lejeune.
Alors que la "téléconsultation pourrait être une réponse dans les territoires où nous manquons cruellement de médecins", la Cour de comptes constate qu’elle est finalement peu utilisée dans les zones prioritaires. A l’exception notable de l’Ile-de-France, premier désert médical français, qui concentre à elle seule plus de la moitié des téléconsultations – le profil moyen du patient téléconsultant étant "jeune et très urbain".
Pour les Sages, la téléconsultation rate sa cible. "Les téléconsultations ne servent pas suffisamment comme repli pour les patients qui n’ont pas de médecin traitant", pointe ainsi Bernard Lejeune : en Ile-de-France, au 1er semestre 2024, seuls 7% des patients ayant téléconsulté un médecin libéral n’avaient pas de médecin traitant (58% ont téléconsulté leur propre médecin traitant, 35% un autre médecin que leur) ; et ils ne sont que 19% s’agissant des plateformes. Le rapport reconnait tout de même que si cette "substitution" par des plateformes est "pertinente pour la prise en charge de pathologies simples", elle "présente d’évidentes limites pour des pathologies plus complexes", qui nécessitent un examen physique.

Néanmoins, pour la Cour des comptes, le suivi des patients chroniques pourrait davantage se faire en alternance en téléconsultation (notamment pour les renouvellements d’ordonnance). Or, seuls 10% des patients en ALD ont bénéficié d’un acte de télésanté en 2023. Pour les Sages, c’est une opportunité manquée de réaliser des économies en diminuant le nombre de transports pris en charge par l’Assurance maladie, notamment, et de gagner du temps médical – une téléconsultation durant en moyenne 9 minutes, contre 16 pour une consultation en présentiel.
Eviter des recours aux urgences : une économie chiffrée à 113 millions d'euros
La téléconsultation ne bénéficie pas assez, non plus, aux patients en Ehpad ou aux patients handicapés, pour lesquels elle permettrait d’éviter des déplacements et des hospitalisations. "Après tout, on a du personnel accompagnant – je pense aux infirmières- qui pourraient permettre de faire un premier point. Mais il faut des équipements : seuls 18% des établissements sociaux et médico-sociaux sont équipés", souligne Bernard Lejeune. Ainsi, seules 0,3% des téléconsultations sont assistées par des infirmières. "C’est marginal", déplore le président de la 6e chambre, qui rappelle que la France compte 100 000 infirmières libérales, dont 90% se déplacent au domicile des patients.
Enfin, "un recours accru aux téléconsultations pourrait également contribuer à diminuer la charge des urgences", considère la Cour des comptes. "Selon une étude des Entreprises de télésanté (LET) de 2023, les médecins des sociétés de téléconsultation prennent en charge une partie des soins non programmés avec un évitement des urgences évalué à 29 %", cite le rapport. Une thèse de médecine de 2021 estime cet allègement à 19%. "Dans l’hypothèse (inférieure à celle des études précitées) où seulement 10 % des téléconsultations dispenseraient d’un déplacement aux urgences, les 5,7 millions de téléconsultations réalisées par les médecins généralistes et les centres de santé permettraient d’économiser 113 M€", calcule la Cour des comptes.
Si la téléconsultation est donc utile, quid de son encadrement ? Pour les Sages, les abus qui ont pu être constatés par le passé sont désormais maitrisés : la prescription d’un arrêt de travail, hors médecin traitant, est limitée à 3 jours et les facturations de majorations de nuit, de dimanche ou de jours fériés, sont restreintes aux urgences ou aux actes régulés. La Cnam joue son rôle de contrôle des facturations et du respect du plafonnement à 20% de l’activité de télémédecine* (40% pour les psychiatres), salue la Cour des comptes : "A l’été 2024, sur les 45 dossiers transmis pour contrôle à la lutte contre la fraude, 30 contrôles étaient en cours et les 15 autres avaient abouti à une procédure devant les juridictions pénales, une procédure devant les juridictions ordinales, cinq procédures de pénalités financières et un déconventionnement, pour un préjudice financier de plus de 1,7 M€".
Pas de "surprescription"
La Cour des comptes approuve par ailleurs le "décrochage" tarifaire entre les téléconsultations et les consultations en présentiel, qui se justifie par le gain de temps.
Quant à la qualité des pratiques en téléconsultation, les données manquent, selon la Cour. "À ce jour, aucune étude n’a permis de comparer finement les pratiques de prescription médicale en consultation et en téléconsultation pour des pathologies identiques, l’absence de connaissance des motifs de consultation faisant obstacle à cet exercice", déplore le rapport. Les études conduites par deux DCGDR* contredisent cependant "l’idée d’un phénomène de surprescription lors des consultations à distance". Au contraire : le nombre de boites de médicaments prescrites par les médecins de plateforme est inférieur : 3,8 en moyenne dans le Grand Est, contre 5 pour les médecins en cabinet ; 3,7, contre 5,6 en Ile-de-France. "Les prescriptions de médicaments consécutives à une consultation au cabinet couvrent un spectre de pathologies et de traitements plus large que ceux liés à une téléconsultation, et donc des classes thérapeutiques plus diversifiées", avance la Cour des comptes.
En revanche, la prescription d’antibiotiques, sensiblement plus élevée sur les plateformes (elle varie de 2 à 18% des actes selon les plateformes, contre 7% pour les généralistes libéraux), reste un point de vigilance et pourrait nécessiter un encadrement strict, reconnaissent les Sages.
Près de 25% de "reconsultation" dans les 15 jours
Par ailleurs, "aucune étude d’ampleur n’a identifié si, à pathologies comparables, la médecine à distance se traduit en France par des taux de reconsultation (en téléconsultation ou au cabinet médical) plus élevés que la médecine exercée au cabinet". D’après la DCGDR Ile-de-France, au premier semestre 2024, la proportion de reconsultation dans les 15 jours après une téléconsultation sur une plateforme s’élevait à 24,4% , contre 19,5% pour les téléconsultations réalisées par des généralistes en cabinet.
Sur la base de ces constats, la Cour des comptes formule six recommandations en faveur d’un développement des téléconsultations en France. Elle préconise ainsi d’ "assouplir les règles conventionnelles de territorialité" qui conditionnent le remboursement des téléconsultations par l’Assurance maladie et sont difficilement contrôlables, en supprimant, en particulier, le critère d’une absence de médecin traitant dans les zones d’intervention prioritaire. "Dans les zones sous denses, on risque d’avoir la double peine de ne pas avoir beaucoup de médecins et de ne pas forcément avoir une offre de téléconsultation à la hauteur puisque par définition on manque de médecins dans ces territoires", fait valoir Bernard Lejeune.
Les Sages recommandent également de "prévoir la possibilité juridique pour les services d’accès aux soins de faire appel, à titre subsidiaire, à des plateformes de téléconsultation". Ils jugent, enfin, nécessaire de relever le plafond pour les médecins retraités.
5000 médecins salariés par les plateformes
En 2023, selon le LET, 5 000 médecins salariés par les sociétés de téléconsultation ont pris en charge 6 millions de patients, ce qui représente 500 ETP, "avec l’hypothèse d’un taux moyen d’activité de 10 %". "L’application individuelle du plafond d’activité de 20 % à chaque médecin salarié constitue une contrainte de gestion pour les sociétés de téléconsultation, relève la Cour des comptes. Pour obtenir un équivalent temps plein, elles doivent recruter au moins cinq médecins, ce qui accroît les problématiques de recrutement et de gestion du temps médical." En 2023, l’activité de ces médecins salariés représentait ainsi 1 % de l’activité totale des généralistes.
*Les patients médecin traitant ne rentrent pas dans ce plafond
**Direction de la coordination de la gestion du risque
La sélection de la rédaction